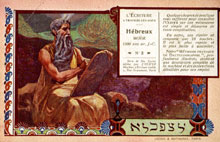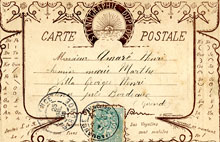| |
|
|
Dictionnaire du Papier(1) | Dictionnaire du Papier(2) | Dictionnaire des outils(1) | Dictionnaire des outils(2) | Dictionnaire des écrits | Dictionnaire de l'écriture(1) | Dictionnaire de l'écriture(2)
| La Calligraphie | Selon la loi du 15 mars 1850 : « l'écriture comprendra les cinq genres d'écriture, qu'on est convenu d'appeler gothique, bâtarde, ronde, coulée et cursive.
L'écriture devra toujours être nette est facile à lire ».
[Charles Higounet, L'écriture, que sais-je ? numéro 653, PUF, 1990.]
En 1880, l'écriture la plus généralement enseignée est la cursive ou anglaise.
La ronde et la bâtarde sont, après la cursive d'un usage courant.
La ronde a été longtemps appelée écriture financière, parce qu'elle était employée surtout dans l'ancienne Chambre des Comptes.
Quant à la bâtarde qui se rapproche plus des caractères romains, elle est employée principalement dans les titres des mémoires ou états.
Cryptographie : L’art d’écrire en écritures chiffrées.
La cryptographie de nos jours (1918) est presque exclusivement employée par les diplomates, les militaires et les commerçants.
D’autres procédés ne rentrent pas dans la catégorie des écritures secrètes : les encres sympathiques, les écrits ésotériques et hermétiques, le jargon utilisé au XVIIe siècle, les vers coupés par le milieu ou à la lecture alternée.
La cryptographie consistait essentiellement en deux systèmes : inversion ou transposition, substitution.
[Nicolas Flamel, La cryptologie, La Nature, 21 septembre 1918] |
| | 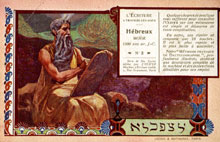 |
Paraphe :
Traits de formes variées qu'on ajoute au nom pour distinguer la signature (XIVe siècle) signature schématique, abrégée souvent formée des initiales du nom (1611)
Sténographie : on entend par sténographie «un système de notes abréviatives qui, entre des mains exercées, peut devenir six à huit fois plus rapides que l'écriture usuelle».
La sténographie ne retient et n’écrit que des sons. Les sténographes pour écrire tous les sons se servent de signes conventionnels.
Les machines à sténographie ou sténôtypes visent à simplifier l'apprentissage et la pratique de la sténographie : la première idée d'une machine à sténographie est due à Gonod, bibliothécaire de Clermont-Ferrand, en 1827, sa machine tachygraphique .
De 1831 à 1910, c'est une centaine de brevets qui furent pris, tant en France qu'à l'étranger pour les machines à sténographie.
[Jean P-A Martin, sténographes et sténographie, La Nature, 19 septembre 1896,
machine à sténographie, Larousse mensuel, numéro 53, juillet 1911, page 164-165.] |
| | 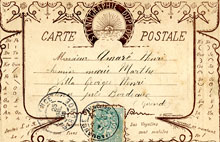 |

| |